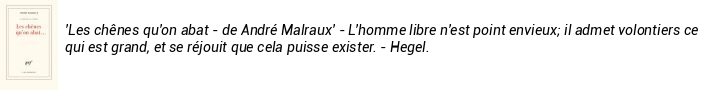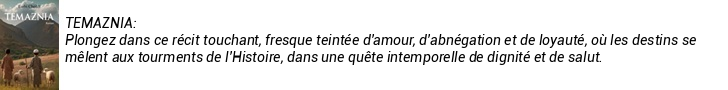Les notions de crédit et de crises économiques :
La notion de crise économique est souvent liée à celle de crédit. Lorsqu'une personne, physique ou morale (comme un État), ne peut plus honorer ses obligations financières, cela signifie que les autres agents économiques ont cessé de croire en elle.
« Le crédit dans le sens : croyance, autorité, foi, pouvoir, confiance, assurance... On dit : Son crédit peut beaucoup ; ou encore : Avoir crédit sur l'esprit de quelqu'un = avoir du pouvoir sur son esprit » (Dictionnaire de l'Académie française). Perdre confiance en quelqu’un, c’est diminuer le crédit que l’on avait pour lui.
La gestion est une science. Les anglophones parlent de management. La finalité est la même : administrer des ressources — humaines en priorité — de manière efficace et efficiente pour pérenniser et accroître le processus de production de l'entité, laquelle est un centre d’intérêt pour divers acteurs, et afin également de maximiser leurs rémunérations.
Dès que cette gestion devient insensée et que les intérêts d’un groupe sont privilégiés au détriment des autres, les gestionnaires responsables de ces actes de « mauvaise gestion » perdent tout crédit. La défiance qui s’installe bloque alors le fonctionnement du système.
La sortie de cet état de crise est souvent conditionnée par le départ des responsables de cette mauvaise gestion.
Institutions financières internationales dans le brouhaha de la contestation !
Aucune personne morale n'est obligée de recourir à l'aide des institutions financières internationales. À titre d’illustration, prenons le cas du Fonds monétaire international, institution souvent diabolisée. Créée dans le but de promouvoir la stabilité financière mondiale, elle est fréquemment critiquée, souvent à tort.
Les préconisations de ce Fonds ont toujours évolué en parallèle avec les discours dominants au sein de l’académie universitaire.
Certaines critiques sont cependant fondées, notamment celles concernant la dérégulation du marché du travail. Certaines de ses recommandations incitent en effet à réduire l’indice de protection de l’emploi, ce qui alimente à la fois les discours d’une gauche irresponsable et d’une extrême droite populiste.
Alors que les vrais efforts devraient porter sur la levée des obstacles à la création d'entreprises...
Mais, en général, ses recommandations relèvent du bon sens.
Politique budgétaire : rémunération des clients politiques !
Souvent, les équipes dirigeantes contraintes de recourir à ces institutions le font après l’échec de leurs politiques économiques.
Recourir à ces institutions revient à faire son mea culpa. Ensuite, l’assistance fournie est comparable à un crédit par signature, qui informe les autres agents économiques que des conditions de bonne gouvernance ont été acceptées.
Les experts de ces institutions ne font qu’appliquer les méthodes apprises dans les écoles, avec les moyens et marges de manœuvre que leur laissent les classes politiques... où les non-dits prédominent.
Les politiques agissent comme des vendeurs désireux de se maintenir, même dans les pays dits développés. Ils récompensent leurs clientèles électorales par des affectations budgétaires ciblées.
Cette méthode est rapide et ses effets sont immédiatement perçus par les « clients » (les électeurs, en l'occurrence). Une bonne gestion, quant à elle, demande du temps, et le temps est précisément ce qui manque dans une « gestion carriériste ».
Il est plus facile de se servir dans le budget pour contenter et récompenser. D'où le détournement de la politique budgétaire de sa finalité : insuffler du dynamisme à l’activité économique.
Dans cette précipitation, on fait l’autruche... Il faudra pourtant affronter, plus tard, les conséquences de ces politiques : la crise.
Autres critiques et idées reçues : législations protectrices des consommateurs...
Parmi les protestataires, certains critiquent les législations relatives aux conditions d’exportation imposées par les pays développés.
Ces textes imposent un « cahier des charges » à respecter pour l’accès à leurs marchés : normes sanitaires, sécuritaires, etc.
Lesdits protestataires les considèrent comme des mesures protectionnistes à l’égard des pays moins développés — contraires au dogme libéral !
Critiquer ces textes revient à cautionner la sous-évaluation de la main-d’œuvre dans les pays en développement, à occulter les véritables causes de la précarité des travailleurs, et à justifier cette exploitation comme facteur de compétitivité.
Or, ces textes visent non seulement à assurer une certaine qualité des produits dans l’intérêt des consommateurs, mais aussi à inciter les dirigeants et industriels des pays en développement à améliorer les conditions de travail de leurs concitoyens — et par là même, la qualité des produits.
En effet, le produit d’un travailleur respecté dans ses droits ne sera jamais le même que celui d’un travailleur exploité...
La réglementation permet une standardisation de la qualité. Son objectif est de défendre les droits des consommateurs. Et, par un effet de rétroaction, de défendre aussi les intérêts et les droits des maîtres d’œuvre — les travailleurs.
Critiquer ces textes revient donc à promouvoir, ailleurs, des formes d’exploitation et de mal-vie comme arguments de compétitivité. Ironiquement, c’est avec cet argument qu’on attire parfois les investisseurs dans ces pays.